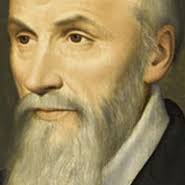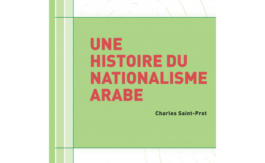La science politique et la Nation
Dr Charles Saint-Prot
Directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques
Charles saint-Prot qui n’est pas un inconnu pour nos lecteurs se livre ici à une fine analyse sur la science politique et la Nation. Étant donnée la longueur de ce texte de conférence, nous en publions aujourd’hui une première partie, et demain nous aurons le plaisir de découvrir la suite. (AF)
D’abord une remarque. Je dirai la science politique plutôt que l’expression chère à Sciences Po qui préfère le pluriel qui permet de faire une sorte de fourre-tout visant à aborder des sujets aussi fondamentaux que les élections de 1921 à 1939 en Haute Corse…
Donc LA science politique. C’est une science car elle étudie et concerne les affaires de la Cité, la polis. C’est tout le sens du mot politique et l’on comprendra que cela n’a rien à voir avec la politique politicienne ou le jeu électoral.
C’est une très ancienne science puisqu’elle apparait dès la Grèce antique avec Aristote et Platon. Elle trouve une nouvelle jeunesse avec les légistes français royaux à partir du XIIème siècle et Jean Bodin (m. en 1596) qui s’intéressent aux mécanismes de gouvernement
Dès lors, sauf à tenir un discours purement partisan, difficile de ne pas considérer la science politique comme une science à part entière… Est-ce une science exacte ? Mais qu’est-ce que ce terme de science exacte recouvre exactement ?
Certes, les sciences sociales n’ont pas la même légitimité, aux yeux du grand public, que les sciences dures. « Les chercheurs ne portent pas de blouse blanche, ils ne manipulent pas des éprouvettes, ils n’envoient pas de fusées sur Mars. »1
Pourtant ce sont des sciences, avec leurs théories, leurs méthodes, leurs modes de validation spécifiques. Et elles ont leur utilité.
Utilité, mais pour qui ? On conçoit bien qu’il ne s’agit pas de donner des recettes aux politiciens comme prétend le faire Machiavel dans Le prince, il s’agit au contraire d’aller à l’essentiel : la cité.
Le père de la science politique moderne, Jean Bodin affirme les principes de « bon gouvernement » dans les Six livres de la República. Il constate l’existence d’un pouvoir public (l’Etat moderne, siège de la puissance souveraine ) jouant le rôle d’unificateur de l’ordre social : l’État et la Nation apparaissent dès lors comme deux réalités étroitement liées.
On remarquera d’emblée que Bodin réfute les empires
Quel que soit le nom dont on les affuble – l’union européenne constituant un ultime avatar de l’idée impériale- les empires ne font qu’enlever aux hommes leur identité sans rien mettre à la place.
Les empires sont des monstres froids qui n’ont ni terre aimée, ni âme collective, ni vraie liberté. Ils traduisent la pesée de la foule sur les âmes humaines, ils ne sont jamais porteur d’humanisme, ils amènent rarement quelque progrès durable dans les esprits. Ils privilégient les foules informes sur les citoyens libres, les conceptions matérialistes sur la civilisation.
Dans ces conditions, l’indépendance de la nation est la plus précieuse des libertés puisqu’il n’est pas de liberté pour un peuple sans la souveraineté.
C’est la nation qui donne à l’homme sa dignité en lui permettant d’être non seulement un animal social mais plus encore un animal historique.
Par la nation, société fondée sur des facteurs permanents et concrets, l’individu périssable et la société périssable défient la mort et le néant. Là est la grandeur de l’homme qui dépasse sa condition éminemment fragile en créant ces refuges contre le temps que sont la nation, la civilisation, l’art.
Par conséquent, Charles Maurras affirmera que toutes les questions politiques « doivent se poser, se trancher, se résoudre par rapport au commun élément national ». Dès lors, la politique qui concerne le bien de la Cité n’est rien d’autre que la science des nécessités de la vie.
Le principe de la défense de la Cité étant posé comme une priorité, il reste à indiquer quelles sont les menaces et quels doivent être les remèdes.
Nous savons que les civilisations sont mortelles mais il ne faut pas s’arrêter à cette évidence, somme toute banale. Les civilisations, les nations, peuvent aussi ne pas mourir à condition de formuler les lois et les conditions de la survie. Il ne faut pas glisser sur la pente allant à l’abîme, à la perte de la nation, c’est-à-dire à l’abandon de notre part d’humanité.
Aujourd’hui, nous voyons bien la force du vieil esprit de démission qui – au cours des siècles- a justifié toutes les collaborations. Les hérauts des idéologies supranationales (le mondialisme qui n’est qu’un simulacre d’universalité, le fédéralisme européen qui est un avatar du mondialisme, les mystérieuses lois du Marché qui battent la mesure…) ne cessent de répéter la ritournelle selon laquelle il n’y aurait pas d’autre politique possible que celle de l’abandon ; c’est toujours le lâche renoncement qui se drape dans un faux réalisme pour proclamer qu’il faut accepter la fatalité des choses. Certains prétendent que le temps des nations est révolu, tandis que d’autres, plus prudents, préconisent une prétendue souveraineté relative et un douteux principe de subsidiarité. Toutes ces convictions absurdes retranscrivent en fin de compte une vision eschatologique tant il est vrai que la fin des nations, c’est la fin de l’Histoire.
Désormais, les idéologies de la mort ont tellement progressé qu’on pourrait se demander s’il y a encore quelque chose à sauver – quand tout s’ingénie à faire reculer la vie. C’est précisément pourquoi, il convient sans cesse de réaffirmer, l’appel à la lutte toujours à recommencer pour l’honneur de l’homme.
Désespérer de la nation conduit à se condamner à ne plus avoir de visage particulier puisque c’est le rempart de la cité libre qui préserve la civilisation. Le défi doit toujours être relevé. Il faut croire en son destin, tenir le rempart de façon à ce qu’on ne puisse pas dire un jour : « Nous n’avons pas assez défendu ce qui nous était commun. Nous ne nous sommes pas assez défendus en tant que nous-mêmes »2.
L’éternel enjeu consiste à réaffirmer le primat de l’homme, de la civilisation, des forces de la vie contre le nivellement matérialiste, contre les nuées cosmopolites, contre les forces de la mort. Comme toujours, c’est l’homme et ses libertés qu’il s’agit de sauver en préservant les droits de la nation, son indépendance et son unité. Si ce mot a un autre sens que celui, étymologique, d’éphémère et de mode, le nationalisme est absolument « moderne » face aux vieilles idéologies totalitaires de l’antihumanisme.
Et puis la nation est le seul bien des pauvres, les classes moyennes laminées par la globalization.
Sauvegardant le citoyen enraciné plutôt que l’individu sans feu ni lieu, la nation relève la valeur de l’homme dans la mesure où elle constitue une communauté de destin dans l’universel. Elle est la condition de l’Histoire. Dès lors, il faut bien en conclure que le nationalisme bien compris est un humanisme.
Contrairement à ce que prétendent les cosmopolites, le nationalisme n’a jamais entretenu la prétention de tout décider comme si le monde extérieur n’existait pas. Le nationalisme n’est pas un chauvinisme, un patriotisme exacerbé, encore moins un racisme fondé sur ce prétendu « matérialisme biologique » exposé par les théoriciens allemands qui ont toujours confondu race et nation.
Le nationalisme ne manifeste pas davantage une quelconque volonté d’expansion et de domination, ce qui est le propre des empires et des hégémonies.
Ce que l’on appelle nationalisme c’est l’idée que le monde est divers. Il s’enrichit de cette diversité par le fait que chaque civilisation apporte sa contribution à la richesse de la culture universelle. Il faut prendre en compte les caractéristiques propres à chaque nation de façon à sauvegarder la diversité du monde. C’est en respectant la personnalité de chacune que le dialogue entre les nations sera le mieux assuré car on ne peut dialoguer qu’avec un autre qui a quelque chose à dire au monde.
De nos jours, la faillite de la politique politicienne ne peut signifier celle du Politique. Une société a besoin d’État, c’est à dire une autorité légitime au service du bien commun. Elle a besoin d’une autorité protectrice, laquelle doit être indépendante des brigues et des factions qui mettent toujours en danger la solidarité nationale.
C’est le premier point que je soulignerai : l’État est au service du bien commun.
L’État au service du bien commun
Selon Bodin, les nations sont en péril lorsque les citoyens perdent le sentiment de former un peuple, une « amitié » au sens où l’entendait Aristote.
L’Histoire enseigne que ce renoncement provient d’un recul de l’autorité. Raymond Aron a bien noté que la crise de l’autorité est la véritable crise des civilisations3.
La menace est celle du totalitarisme qui prospère toujours lorsque s’effondrent les autorités traditionnelles : l’école, la famille, le pouvoir politique. Comme l’écrit Hanna Arendt, le totalitarisme a fini au XXe siècle de ruiner l’autorité, mettant un point d’orgue au mouvement entamé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Soyons clairs : la fracture entre le pays réel, la grande majorité des citoyens, et le pays légal, les prétendues élites, est de moins en moins contestable. Les signes en sont nombreux : abstention, revendication du vote blanc, vote pour les « radicaux »…
Mais la méfiance d’une partie du peuple à l’égard de la classe politique ne signifie pas que les citoyens veulent l’anarchie. Au contraire, le peuple souhaite la restauration d’un État fort et juste, juste car fort. Il veut un État au service du bien commun
De nos jours, la crise de l’autorité que diagnostiquait Raymond Aron après l’agitation de mai 1968, a conduit le plus grand nombre à perdre de vue la notion de bien commun, d’intérêt général, de chose publique (la res publica).
Beaucoup de nos contemporains sont tentés de se retrancher dans les petits bonheurs individualistes ou la tentation communautariste qui encourage la montée en puissance de pseudo-identités ethniques, religieuses, sexuelles, socioculturelles ou locales. Ce morcellement a un nom, le tribalisme.On peut se demander si les tribus sectaires ne vont pas remplacer la communauté nationale. C’est d’ailleurs ce que prédit le philosophe Zygmunt Bauman4
Du coup, la priorité est de restaurer l’idée de bien commun qui consolide la citoyenneté.
C’est une idée fondamentale de nos civilisations. Depuis Aristote, l’idée prévaut que les hommes ont quelque chose de fondamental, d’essentiel, en commun. Le bien commun est ce qui donne du sens au corps social.5
D’après saint Thomas d’Aquin, pour exister la cité suppose, « l’existence d’un bien commun, car le bien de la cité est d’une dignité plus élevée… que celui de chaque individu pris en lui-même. »
Avec les légistes du Moyen Âge dont la pensée et les principes ont été exposés par Jean Bodin dans ses Six livres de la Res publica ( 1576)6, l’idée du pouvoir qui prévaut est que la souveraineté est au service du bien commun.
Il est intéressant de noter que l’on retrouve ce concept dans la pensée islamique. Selon l’Islam, certaines valeurs représentent des objectifs supérieurs (maqâssid): la religion, la vie, la raison, les biens matériels, la famille et la dignité de l’être humain.
La maslaha est le moyen par lequel on préserve ces objectifs supérieurs. La maslaha s’inspire de l’objectif général de rechercher le bien et de bannir le mal. Plus largement, on peut dire que maslaha signifie l’intérêt public, le bien commun.7
Aujourd’hui, quel est notre bien commun ?
La question est d’importance puisqu’une société qui perd le sens du bien commun est une société condamnée.
Réfléchir sur le bien commun consiste à prendre la mesure du danger de l’individualisme et du communautarisme pour se référer à notre traditionnelle conception du lien social, qui privilégie les valeurs d’unité et d’égalité face à l’exaltation de prétendus droits de prétendues communautés.
Une sorte d’idéal postmoderne vise à célébrer des communautés de plus en plus nombreuses, ce qui tend à favoriser le communautarisme. Comment ne pas considérer comme une régression le discours de ceux qui détricotent la société nationale, ceux qui flattent des « catégories » auprès desquelles ils multiplient les promesses démagogiques.
Le rôle du politique consiste à réaffirmer sans relâche la conception du lien social privilégiant les valeurs d’unité et de fraternité qui s’opposent à l’idée d’un individu isolé, replié sur lui-même ou dans un groupe particulier et sectaire.
Donc l’État est au service du bien commun ; Nous ne pouvons d’ailleurs que constater l’extrême misère des pays où l’État est défaillant. Je pense par exemple à la Libye, à l’Afghanistan, à l’Irak, au Liban…
L’État est une nécessité. Ce postulat étant posé il faut bien se demander de quel État nous parlons ? Je n’entends pas ici tel ou tel modèle institutionnel : monarchie, république, régime autoritaire, régime présidentiel, régime parlementaire… Ce n’est pas l’objet de ce débat. Mon questionnement est la suivant : quel État pour quelle société ? (à suivre)
1 Nonna Mayer, Nouvelles FondationS 2006/2 (n° 2), pages 42 à 48
2 Charles Maurras, Quand les Français ne s’aimaient pas, 1916.
3 Plaidoyer pour l’Europe décadente
4 Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics. Cambridge, Basil Blackwell, 1993.
5 Aristote. Les politiques, VII, 8.
6 Bodin, Jean. Six livres de la République [1576], Paris, LGF – Livre de Poche, 1993.
7 V. notre ouvrage Islam. L’avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation. Paris-Monaco, Le Rocher, 2008.