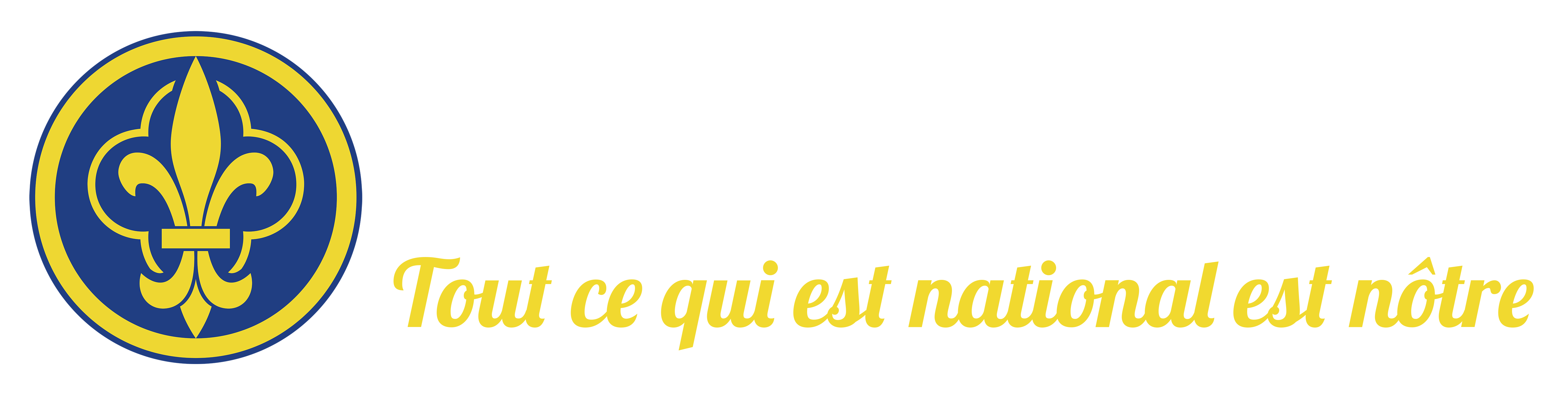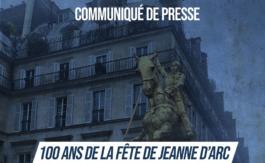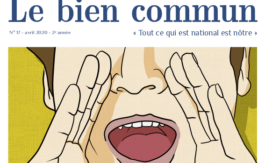Par Gérard Leclerc
On ne saurait sous-estimer l’importance de ce fait de guerre sans précédent, qui fut à l’origine de la libération de notre territoire et permit la victoire définitive contre un régime criminel par essence, dont on ne pouvait souhaiter que la fin définitive. Que les chefs d’État se retrouvent sur les lieux historiques de cette épopée, aux côtés des derniers vétérans du 6 juin 1944, on ne peut que s’en féliciter, ne serait-ce qu’en gage d’un avenir voué à la paix et à la concorde entre les peuples.
Mais l’actualité la plus brûlante est là pour nous avertir que dans ce monde rien n’est jamais définitivement gagné. Emmanuel Macron n’a-t-il pas annoncé, en ces circonstances, un engagement armé supplémentaire de la France en Ukraine ?
Ce qui devrait provoquer en nous le rappel de la complexité de l’Histoire. La victoire de la Seconde Guerre mondiale n’aurait pas été possible sans le concours de l’armée soviétique, sous l’autorité d’un certain Joseph Staline. Le prix à payer de cette alliance fut la division de l’Europe et même du monde en deux, avec l’expansion du communisme. Situation qui ne prit fin qu’en 1989 avec la chute du Mur de Berlin. Ainsi, toute commémoration oblige à ressaisir les perspectives longues sans lesquelles notre situation présente est inintelligible.
C’est pourquoi il convient de revenir à la conférence magistrale prononcée en l’abbatiale de l’Abbaye-aux-Hommes de Caen par le cardinal Joseph Ratzinger en 2004, à l’occasion du soixantième anniversaire du Débarquement. Envoyé spécial de Jean-Paul II, le pape polonais, sa nationalité allemande lui conférait une tonalité toute particulière. N’avait-il pas souhaité, de toute son âme, la victoire alliée, au moment même où son pays était écrasé ?
Ce fut pour lui l’occasion d’une réflexion d’une richesse étonnante, en pleine connaissance des malheurs du monde, avec les vues historiques les plus larges mais aussi les leçons à retenir sur le terrain de la politique et du droit. La menace djihadiste ne lui échappait pas plus que les difficultés des pays d’Occident à mettre en cohérence leur présent et leur héritage chrétien. On pourrait en retenir cette formule : « Un État, même laïc a le droit, et même l’obligation de trouver son support dans les racines morales marquantes qui l’ont construit. Il peut et il doit reconnaître les valeurs fondamentales sans lesquelles il ne serait pas devenu ce qu’il est et sans lesquelles il ne peut survivre. Un État réduit à sa raison abstraite, anhistorique, ne saurait subsister ».
Les nations, en la personne de leurs chefs d’État, qui célèbrent un grand moment de leur passé sont aussi amenées à réfléchir à ce qui a constitué le plus pur de leur identité morale avant d’affronter un avenir pour le moins problématique, si ce n’est dangereux.