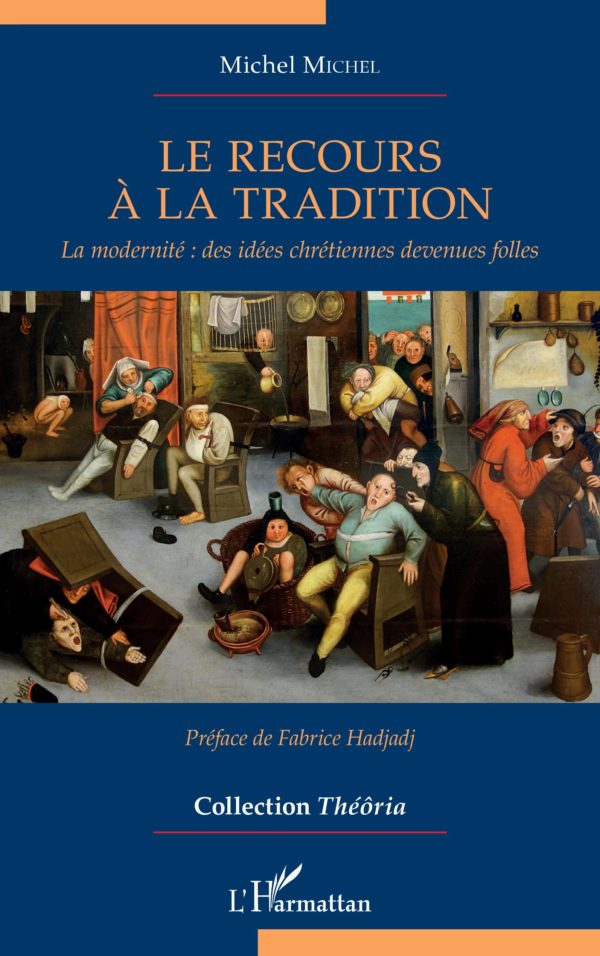Par Paul Ducay
Sous le titre Le recours à la tradition, le sociologue catholique Michel Michel, maître de conférences à l’Université des Sciences Sociales de Grenoble, a réuni un ensemble de réflexions formant une critique « théologico-politique » de la modernité : si celle-ci est bien issue du christianisme, c’est sous la forme d’une hérésie, à laquelle l’Église catholique doit répondre en reconnaissant son fond traditionnel commun aux autres religions.
Comme l’indique expressément le sous-titre du livre de Michel Michel, le diagnostic que l’auteur propose de la société moderne constitue une exégèse d’une célèbre citation de G. K. Chesterton en 1908 : « Le monde moderne est plein d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles. » Que « tout dans le monde moderne est d’origine chrétienne », comme l’affirme encore l’écrivain anglais, qu’est-ce que cela signifie exactement et que faut-il y voir ? Les chrétiens « modernistes » auraient-ils raison d’embrasser les valeurs, les mœurs et les représentations du monde moderne, parce que celui-ci est issu du christianisme ? Ou bien, à l’inverse, les « néopaïens » auraient-ils raison d’être anti-chrétiens par rejet de la modernité ? Michel Michel considère ces deux attitudes de louange et de blâme comme deux opposés gémellaires, solidaires d’une même erreur : celle d’envisager la modernité comme fille légitime du christianisme, alors qu’elle en est une fille illégitime. La modernité, pour Michel, n’est ni une époque, ni une œuvre fidèle du christianisme, mais une hérésie, comme le christianisme en a connu d’autres dans son histoire.
L’hérésie moderniste
Michel développe et étend le point de vue adopté par Chesterton dans ses Hérétiques pour résoudre ce sérieux problème de généalogie, dont l’irrésolution en a entraîné plus d’un dans les errances du modernisme ou dans celles du néo-paganisme : comment se peut-il que la modernité présente, sous les rapports de la pensée et de l’action, une franche opposition à l’Église catholique, tout en utilisant les idées du christianisme de manière sécularisée ? La notion qui, en fait, permet de rendre compte de ce double caractère de trahison et d’héritage du christianisme dans la modernité est celle d’hérésie. Comme l’explique le philosophe Fabrice Hadjadj dans sa préface au livre de son beau-père Michel Michel, « “hérésie” [vient] du mot grec qui signifie “choix” [haíresis]. Ce choix, qu’on pourrait prendre pour un accomplissement de la liberté, accueille une partie du vrai afin de mieux rejeter l’autre. […] Comme de bien entendu, ces hérésies dépendent de l’héritage, mais c’est un héritage sans testament, qu’on dilapide loin de la maison du Père. » Tandis que l’héritier fait l’effort de transmettre l’essence entière du dépôt reçu, l’hérétique, au contraire, mutile cette transmission en sélectionnant et arrangeant à sa guise une partie de ce dépôt. C’est pourquoi, remarque Michel, « il ne faut pas […] confondre le christianisme et les hérésies dont il est porteur » malgré lui. Une telle confusion est pourtant une tentation d’une partie de l’Église elle-même, ce que Pie IX a appelé le « modernisme ». Pourquoi ? Si « l’Église est si faible devant les idéologies modernes », c’est parce qu’« elle se reconnaît dans l’attente d’un Monde Nouveau ». L’eschatologie chrétienne se reconnaît en partie dans la croyance moderne au Progrès historique.
Cette reconnaissance a cependant le défaut de négliger l’opposition essentielle des points de vue : spirituel et éternel pour le christianisme, matériel et temporel pour la modernité. Au point de vue traditionnel en effet, la rédemption du monde doit se réaliser au-delà de l’Histoire, puisque l’Histoire n’est que le récit de l’éloignement de l’Homme à l’égard de son Principe. Nier le caractère négatif du devenir historique reviendrait à nier la Chute dont il est l’effet exclusif. En effet, comme l’explique philosophiquement Michel à partir des analyses littéraires de Vladimir Propp sur les contes, « il n’y a pas d’histoire possible sans accident, sans rupture de la norme. Toute histoire est d’abord l’histoire d’un malheur. […] La chute est la condition même de l’histoire. […] Le cardinal Daniélou le remarquait : à partir du chapitre 3 de la Genèse, l’histoire, c’est l’histoire du progrès du mal dans ce monde, et ce fut semble-t-il la conception dominante des chrétiens jusqu’à la fin du Moyen Âge. »
À l’inverse, l’idéologie moderne du Progrès consiste à penser que l’histoire est une chance, qu’elle suit une tendance immanente d’amélioration progressive des conditions de la vie matérielle, morale et spirituelle de l’Homme. De cette théorie résultent les idées contradictoires d’une fin de l’histoire dans l’histoire, d’un affranchissement de la misère humaine par les conditions mêmes de la vie matérielle. Là-dedans, le moderniste chrétien hésite, car il hérite de la version du millénarisme proposée par Joachim de Flore (1135-1202), « ce moine calabrais qui imagina trois âges dans l’histoire du monde : l’âge du Père, l’âge du Fils et l’âge de l’Esprit Saint. Il est le modèle de toutes ces hérésies post-chrétiennes que sont les philosophies progressistes de l’histoire à trois temps, qui dominent l’imaginaire occidental depuis la grande rupture de la fin du Moyen Âge. »
Deux œcuménismes
Michel identifie ainsi dans l’histoire du christianisme deux fonctions antagonistes : « celle de religion du salut et celle d’idéologie corruptrice de la société. L’une est portée par l’Église, l’autre par les hérésies qui trouvent leur source dans cette même Église ». L’hérésie moderne retient du christianisme sa puissance de désorganisation en séparant ses idées principales de leur horizon théologique ou surnaturel : l’Homme devient objet de foi à la place de Dieu, son histoire immanente devient le motif de l’espérance à la place de l’éternité, la lutte politique et les œuvres humanitaires se substituent à l’amour du prochain en vue de sa sanctification.
Dans ces conditions, la composition de l’Église avec le monde moderne n’est pas une nouvelle forme de relation avec des « païens » d’un genre nouveau, mais une composition de l’Église « avec sa propre hérésie ». Cela est bien différent, car l’hérésie moderne sépare le christianisme des autres religions en fondant sa supériorité et son originalité sur ce qui ferait du christianisme la « religion de la sortie de la religion », en raison de son caractère supposément laïque et révolutionnaire. Or en adhérant à la mentalité moderne, des représentants de l’Église catholique ont, malgré leurs récentes prétentions favorables aux dialogue interreligieux, engendré une perte générale du sens du sacré. Ce sens du sacré, c’est-à-dire la (re)connaissance des hiérarchies naturelles, de l’ordre surnaturel et de la fidélité rituelle à celui-ci, constitue pourtant le ciment commun des religions, la condition sine qua non d’un fructueux dialogue entre elles. Au contraire, l’abandon de la connaissance sacrée est la cause d’une désaffection du sacerdoce et d’une incompréhension massive des symboles et des sacrements chrétiens, à tel point que, par exemple, « deux tiers des catholiques américains ne croient plus en la présence réelle [du Christ dans les espèces du pain et du vin eucharistiques] : c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le Pew Research Center, le 5 août 2019. »
C’est pourquoi, quels que soient les reproches que l’Église peut adresser aux autres religions traditionnelles, il faut bien constater qu’elles reconnaissent, comme elle, « la supériorité et l’autorité de principes transcendants, toutes se soumettent – ou du moins l’affirment – à une “loi non écrite” d’origine supra-humaine, toutes savent que l’homme n’est ni sa propre origine, ni sa propre fin. » Michel s’indigne que les initiatives œcuméniques ne concentrent pas, dès lors, toute leur attention sur cette unité transcendantale des religions. Il déplore qu’« en pratique, l’œcuménisme consiste […] à rapprocher l’aile moderniste du catholicisme avec l’aile progressiste du protestantisme » et à mêler, dans un dialogue relativiste par défaut de critère métaphysique défini, les croyances religieuses et irréligieuses dans un but très insuffisant et vague d’amitié sociale. Au lieu de cela, un œcuménisme bien compris, c’est-à-dire un œcuménisme traditionnel procédant « par le haut » et non un œcuménisme moderniste procédant « par le bas », devrait plutôt « retrouver les traditions communes des Églises apostoliques » et, à plus forte raison, « montrer les admirables correspondances du catholicisme avec les croyances et les rites des autres religions, comme le faisaient les théologiens de la Renaissance ou les traditionalistes du début du XIXe siècle, au lieu de s’ingénier comme les mauvais apologistes “modernes” naïvement ethnocentristes à inventer des différences ou des supériorités. »
Le recours à la Tradition
L’ambition affichée de Michel est donc celle du pérennialisme, c’est-à-dire de « ce traditionalisme [attribuable] à S. Augustin, à S. Vincent de Lérins, [au cardinal] Nicolas de Cues ou Joseph de Maistre ». Le problème, faute d’une méthode œcuménique adaptée aux conditions d’une véritable anthropologie religieuse, est que « les théologiens catholiques se sont détournés de ces perspectives ; si bien qu’on est obligé de chercher hors de l’Église ces conceptions qui pourtant sont aussi les siennes. Hors de l’Église et tout particulièrement chez René Guénon », ce grand nom français du soufisme et de la métaphysique orientale.
Dans cette perspective guénonienne, recourir à la Tradition, c’est entreprendre la connaissance des nombreuses correspondances mythiques, symboliques et rituelles qui démontrent l’existence de cette « tradition perpétuelle et unanime » (Guénon) d’où le christianisme lui-même est issu, de cette tradition que S. Vincent de Lérins définit comme étant « ce qui a été cru par tous, partout et toujours ». En effet, les interprètes du christianisme affectés par le point de vue moderne (l’auteur cite René Girard) n’ont pas su reconnaître, avec Joseph de Maistre au XIXe siècle et René Guénon au XXe siècle, que « l’universalité d’une croyance ou d’un rite – les sacrifices, par exemple – attestait de la vérité des pratiques de l’Église catholique. » Pourtant, la connaissance d’un sens universel et unique sous-jacent au contenu doctrinal et rituel des religions entraîne a minima la confirmation du caractère sacré des Écritures, de la symbolique et de la ritualité chrétiennes, contre les entreprises démystifiantes et matérialistes de la modernité.
La découverte par l’Église de l’œuvre de René Guénon et de ses héritiers est donc capitale pour satisfaire cette ambition, pourvu que l’exercice intelligent de discernement soit effectué. Mais ce qui est vrai au niveau du culte doit forcément l’être aussi au niveau de la culture, car, explique Michel, « si la Tradition se transmet, c’est habituellement par les traditions et singulièrement le langage et tout ce qui hétérogénéise l’espace (les hauts lieux), le temps (les fêtes), les hommes (les “vocations” particulières) et ordonne le monde ». C’est pourquoi, par exemple, « si un ethnologue venu de Sirius débarquait dans nos contrées, il constaterait que par leurs structures, elles sont massivement chrétiennes ou romano-helléno-judéo-chrétiennes : semaine de sept jours, clochers qui dominent les agglomérations, prénoms se référant à des saints, valeurs morales largement inspirées du Décalogue, etc ». En renouant avec la connaissance sacrée des mystères de la religion chrétienne, l’enjeu est donc, plus largement encore, de rendre intelligible le langage de toute la culture occidentale. Et mortui resurgent.
*Article paru sur le blog :