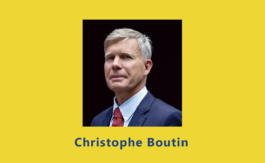Par Pierre Gourinard
Ernest Renan avait écrit La Réforme intellectuelle et moraleau lendemain de la défaite de 1870, dans la douleur du désastre. C’est l’ouvrage le plus réactionnaire de la seconde moitié du XIXe siècle. Renan, qui collabore au Journal des débats orléaniste, se rallie à la République mais c’est comme à un pis-aller. Il n’a pas l’esprit des « couches nouvelles » que Gambetta a éveillées à l’idée républicaine. Renan, s’il accepte la République, n’est pas républicain de conviction et s’il n’aime pas les monarchistes, qu’il juge à tort ou à raison butés en matière religieuse et politique, il défend la monarchie.
Deux faits sont essentiels dans la pensée de Renan :
• D’abord, il ne croit pas à l’utopie qui selon lui affecte les Français. Après chaque expérience manquée, ils recommencent. On n’a pas trouvé la solution, on la trouvera. L’idée ne leur vient jamais que la solution n’existe pas.
Renan n’a aucune confiance dans les règlements qui, à peine élaborés, se révèlent inapplicables et pesants et qui, au lieu de permettre une amélioration, bloquent la machine et interdisent sa marche.
• En second lieu, Renan pense que la France est avilie par le suffrage universel car, dès que l’électeur peu éclairé abandonne son horizon immédiat et familier, il ne peut qu’errer.
Il estime que la démocratie, condamnable dans l’immédiat, ne l’est pas moins dans la perspective de l’accomplissement de l’homme. Non seulement il critique la démocratie au suffrage universel qui l’exprime, mais il marque ses distances à l’égard de la Révolution française, d’où est sorti le monde contemporain et dans lequel, aristocrate de la culture, il se sent mal à l’aise :
« Si 89 est un obstacle pour cela, renonçons à 89. Rien n’est plus fatal à une nation que ce fétichisme qui fait placer son amour propre dans la défense de certains mots avec lesquels on peut la mener pourvu qu’on s’en couvre, aux derniers confins de la servitude et de l’abaissement. »
Il est une autre page de Renan, moins connue, prononcée en séance publique de l’Académie française, qui rend un son plus grave. Daniel Halévy l’avait retenue dans son Histoire d’une histoire, esquissée pour le troisième cinquantenaire de la Révolution française. Dans ces pages qui datent de 1889, il écrit :
« Si, dans dix ou vingt ans, la France est toujours à l’état de crise, anéantie à l’extérieur, livrée à l’intérieur aux menaces des sectes et aux entreprises de la basse popularité, ah ! Alors il faudra dire que notre entraînement d’artistes nous a fait commettre une faute politique, que ces audacieux novateurs pour lesquels nous avons eu des faiblesses eurent absolument tort. La Révolution, dans ce cas, serait vaincue pour plus d’unsiècle. En guerre, un capitaine toujours battu ne saurait être un grand capitaine : en politique, un principe, qui, dans l’espace de cent ans épuise une nation, ne saurait être le véritable. »
Dans la Réforme intellectuelle et morale, œuvre à laquelle il faut toujours revenir, la critique est plus nette encore et elle annonce Maurras et sa condamnation de la République, considérée comme la « femme sans tête » :
« Le jour où la France coupa la tête à son roi, elle commit un suicide. La France ne peut être comparée à ces petites patries antiques, se composant, le plus souvent d’une ville avec sa banlieue, où tout le monde était parent. La France était une grande société d’actionnaires, formée par un spéculateur de premier ordre, la maison capétienne. Les actionnaires ont cru se pouvoir passer du chef et puis, continuer seuls les affaires. Cela ira bien tant que les affaires sont bonnes, mais les affaires devenant mauvaises, il y aura des demandes de liquidation. »
Ainsi se dessine la préférence de Renan pour la monarchie légitime et pour le moins mauvais régime après elle, son succédané orléaniste, encore que la Monarchie de Juillet ait eu le tort de ne pas résister, de ne pas croire en elle-même, de céder la place au plus vite et aux plus exaltés. Le roi et ses fils, au lieu de maintenir leurs droits par les armes se retirèrent et laissèrent l’émeute parisienne violer outrageusement la volonté de la nation. C’était une déchirure funeste, faite à un titre un peu caduc en son origine, et qui ne pouvait acquérir de force que par sa persistance.
Une dynastie doit à la nation, qui toujours est censée l’appuyer, de résister à une minorité turbulente. L’humanité est satisfaite pourvu qu’après la bataille le pouvoir se montre généreux et traite les rebelles non comme des coupables, mais comme des vaincus.
Le libéralisme critique de Renan préfigure les conclusions formulées entre les deux guerres mondiales, plus précisémentpar Charles Benoist et André Tardieu.
André Tardieu, ancien collaborateur de Clemenceau, plusieurs fois ministre et président du Conseil, se retira de la vie politique en 1936 et concluait ainsi le dernier de ses ouvrages : « Après avoir lu mon livre, les Français doivent appeler le duc de Guise ».